L’élevage bovin a toute sa place dans un cercle vertueux du carbone. Face au méthane émis et à la consommation d’intrants, la production laitière permet de nourrir, de stocker du carbone dans ses prairies et son bocage. Quelques conseils pour alléger son bilan carbone et défendre sa production. [SOURCE : AGRISALON]
« L’élevage pollue » entend-on souvent. Pour tordre le cou à cette idée reçue et progresser sur leurs pratiques, des éleveurs se font accompagner par une société de conseils, la Vache Heureuse, portée par Konrad Schreiber et Anton Sidler. Il y a quelques semaines, ils ont échangé sur les gaz à effet de serre.
« Les gaz à effet de serre comme les nitrates ne sont pas des fatalités de l’élevage. En adaptant ses pratiques, il est possible de concilier production et environnement », prône, depuis des années, Konrad Schreiber.
Agriculteur et chargé de mission à l’Institut d’agriculture durable, Konrad Schreiber est connu pour ses travaux sur les techniques culturales simplifiées. Il défend également la place de l’élevage. « Un élevage qui disparaît, c’est de la pollution en plus, assure-t-il. Les nitrates vont fuir des prairies labourées, il y aura plus de phytos sur des grandes cultures ». Il rejette l’idée que pour diminuer les gaz à effet de serre, il faut réduire le nombre de ruminants, qui, certes, éructent du méthane, l’un de ces gaz qui augmentent le réchauffement climatique. Au contraire, pour concilier le défi de la sécurité alimentaire pour tous avec les objectifs de la COP 21 de diviser par 4 les gaz à effet de serre, d’ici à 2050, il faut miser sur l’agriculture. « L’agriculture est l’une des solutions, car en plus de nourrir, elle séquestre le carbone dans les sols », martèle Konrad Schreiber.
La loi sur la transition énergétique a gravé dans le marbre l’obligation de réduire les émissions de gaz à effet de serre, en donnant une valeur monétaire à la tonne de carbone et des risques de pénalisation si ses émissions ne réduisent pas.
Déjà, les plus grosses entreprises qui n’ont pas réussi à réduire leurs pollutions rachètent des tonnes de carbone non émises à des usines plus propres.
Est-ce qu’une telle taxation pourrait s’appliquer à l’agriculture, qui représente 19 % des gaz à effet de serre émis par la France ?
« Pour l’éviter, nous devons poursuivre le changement de nos pratiques et montrer tout ce que l’agriculture apporte, en termes de séquestration de carbone et de productions alimentaires », encourage Konrad Schreiber.
Et de citer la Suisse qui alloue des primes aux pratiques vertueuses sur la gestion du carbone.
Réduire son empreinte carbone
Pour alléger son bilan carbone, le premier levier est d’augmenter le stockage de carbone dans le sol de prairies permanentes, dans les arbres par des haies ou de l’agroforesterie. C’est au travail du sol que le carbone séquestré rejoint l’atmosphère. En ne travaillant plus le sol, on peut stocker jusqu’à une tonne de carbone à l’hectare. « Il faut réduire le travail du sol et améliorer les couverts végétaux. Un méteil assure en même temps la couverture du sol en hiver et fournit des protéines aux vaches, donc de l’autonomie alimentaire », encourage Konrad Schreiber.
La maîtrise de ses émissions de gaz à effet de serre passe aussi par une optimisation de la production par vache. La rumination, donc l’éructation de méthane, est quasiment la même, quelle que soit la production. Une meilleure efficacité alimentaire, un troupeau en bonne santé, qui vêle à 24 mois et a une bonne longévité permet de réduire l’effectif, à production livrée équivalente.
Chiffrer son bilan carbone
Si tous les organismes agricoles s’accordent sur les pratiques allégeant le bilan carbone, les points de vue divergent sur la façon de le calculer. SelfCO2, mis au point par Idele, met en balance le potentiel nourricier de l’élevage, son apport à la biodiversité et au stockage du carbone, par exemple dans les prairies et ses consommations, via les carburants, les achats d’aliments… Le modèle CAP2ER va plus loin en calculant les grammes de CO2 par litre de lait produit. En moyenne, les élevages sont à 1 kg de CO2 par litre de lait.
Pour l’association La Vache Heureuse, le bilan carbone doit se baser sur le cycle de vie du carbone renouvelable et prendre en compte la production alimentaire « car c’est un apport favorable pour la société, explique Konrad Schreiber. L’agriculture ne pollue pas grâce à la production alimentaire. Les cultures captent le carbone, qui est restitué, certes, sous forme de gaz à effet de serre mais surtout d’alimentation ». Il faudrait aussi comptabiliser le bilan humique des sols « car un sol qui fonctionne bien stocke plus de carbone ». L’optimisation des pratiques permet de transformer l’agriculture en puits de carbone. Au 1 kg de CO2 par litre de lait, le stockage dans les prairies et l’optimisation de production permet de retrancher 0,5 kg. Des sols toujours couverts et en semis direct allègent encore le bilan de 0,44 kg. Si on plante 40 arbres par hectare, on peut stocker encore 0,75 kg de CO2. « Avec tous les éléments, on passe d’un bilan carbone de 1 kg CO2 par litre de lait à – 0,7 »
L’élevage est l’un des rares secteurs à pouvoir compenser ses émissions de carbone par du stockage (prairies, haies…) et de la production d’énergie verte par la méthanisation. Il faut le faire savoir !

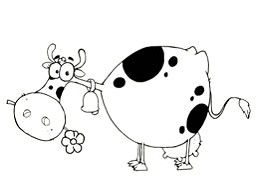
Commentaires récents